APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque international:
Les thèmes de la phénoménologie contemporaine
Varsovie, du 23 au 26 mars 2017
La phénoménologie contemporaine se présente d’une part comme une discipline strictement définie, qui possède sa méthode propre, un objectif et l’objet d’études ; d’autre part, elle est un mouvement très diversifié, en changement continuel, entrant en dialogue avec d’autres sciences humaines. Lors du colloque, nous voudrions nous interroger sur les tendances les plus significatives de la phénoménologie contemporaine, tenant compte de ses croisements avec d’autres disciplines pour en discuter des enjeux.
Les questions porteront sur les thèmes suivants:
Phénoménologie du corps
Des tendances philosophiques du passé et du présent qui posent les questions de corporéité, la phénoménologie semble les traiter de la manière la plus fondamentale, à savoir qu’elle les place dans le domaine de l’ontologie, et même de la métaphysique. On le remarque déjà dans les œuvres de Husserl, bien que l’on retrouve les développements les plus pertinents et les plus originaux de cette problématique principalement dans la phénoménologie française. La génération actuelle de phénoménologues a déjà signalé sa propre interprétation de la question de corporéité. Leur confrontation, par rapport à la nature fondamentale mentionnée ci-dessus, avec de nombreuses approches au problème de corps, est donc indispensable.
Phénoménologie de l’intersubjectivité
L’un des défis majeurs de la phénoménologie consiste à décrire les phénomènes complexes qui se produisent dans l’espace social perçu dans une perspective transcendantale et strictement philosophique, sans pour autant oublier les liens avec la dimension originaire : sa dimension singulière d’impression/de vécu/d’expérience. Les questions retravaillées au cours des dernières années dans la phénoménologie et dans les domaines limitrophes reprennent la tendance à réunir en un seul horizon de nombreux motifs, tels que la sensation, le corps propre, la relation érotique ou la relation éthique avec des motifs de la vie sociale et de la politique.
Phénoménologie et théologie
La phénoménologie pose à nouveau frais la question de Dieu, fortement présente dans la tradition philosophique. Tout en suivant le geste initial de Husserl, cette question est soumise à des réductions nécessaires afin d’approcher les formes spécifiques des phénomènes ou des figures phénoménales propres à l’expérience religieuse et sous l’inspiration théologique. Ce faisant, il ne s’agira pas de défendre ou de fournir un nouveau type d’une « théologie phénoménologique » mais de développer une formule plus large de la phénoménologie comme telle. Pour accomplir cette tâche, il faudra avancer vers les frontières de la phénoménologie pour en redéfinir des limites tout en décrivant des phénomènes clés, tels que le phénomène de l’appel, celui de la question et de la réponse, de la naissance et de la mort, du don et de la donation, de l’amour, de l’incarnation, d’événement, et enfin de révélation.
Phénoménologie et esthétique
Au cours des dernières décennies, l’art est devenu le leitmotiv de nombreuses recherches phénoménologiques. Dans leurs efforts de décrire l’expérience qui leur permettrait d’atteindre ce qui est originaire, certains phénoménologues se sont tournés vers l’expérience esthétique. Grâce à cette expérience, il est possible de découvrir ce qui reste insaisissable dans la perception ordinaire et qui, en même temps, la détermine, en révélant ainsi l’importance de la sphère d’aisthesis. La problématique de la phénoménologie de l’art englobe diverses formes d’art qui sont analysées à l’aide de l’appareil conceptuel développé par la phénoménologie : analyses de la peinture à travers la photographie jusqu’à l’art des nouveaux médias et les images en mouvement, un combat phénoménologique avec le langage poétique, ainsi qu’une réflexion sur l’art et son importance pour les recherches phénoménologiques, à savoir sur le tournant esthétique dans la phénoménologie.
Phénoménologie et psychanalyse
Après s’être frayé un passage à travers les différences terminologiques associées aux origines différentes et les installations théoriques de ces deux mouvements, nous sommes en mesure d’indiquer des constructions similaires décrivant la structure la plus profonde de l’expérience. Ces mouvements semblent complémentaires, en particulier parce qu’ils examinent la constitution du phénomène de la conscience dans le domaine de l’inconscient; et la constitution du sens où il n’est pas encore. La différence primordiale entre ces deux domaines n’est pas impliquée par la connaissance de ce qui est expérimenté, mais par l’attitude envers cette expérience.
Phénoménologie et sciences cognitives
Une des tendances de la phénoménologie contemporaine est de rechercher des liaisons avec le domaine interdisciplinaire des sciences cognitives. La phénoménologie, y compris sa méthode, dont les éléments sont utiles pour étudier des états subjectifs de l’expérience, fournit aux sciences cognitives une analyse avancée de la structure de la conscience, de l’incarnation ou de l’intersubjectivité. Les positions proposées, telles que la neuro-phénoménologie, l’enaction ou la phénoménologie d’une phase initiale, proviennent des réalisations antérieures de la phénoménologie à des degrés divers. En outre, on indiquera le problème de la « naturalisation de la phénoménologie », qui est mis en question tant par les chercheurs en sciences cognitives que par les phénoménologues.
Phénoménologie et féminisme
La pensée féministe est un domaine important d’influence de la phénoménologie, d’utilisation des méthodes phénoménologiques, ainsi que de la critique de la phénoménologie. Les relations entre les deux mouvements émergent principalement dans les questions concernant la corporéité (expérience du corps féminin, spécificité sexuelle des mutations du corps, question du « corps propre »); l’identité (construction du sujet féminin; identification des phénomènes liés à la subjectivité féminine, expérience du genre); et la rencontre avec l’Autre (genre comme facteur de différenciation). L’interprétation de la phénoménologie par le prisme des théories contemporaines de la différence du genre et du sexe rend possible l’analyse des problèmes de la phénoménologie d’une autre perspective.

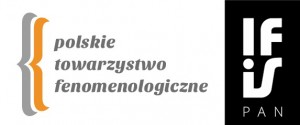
Les Organisateurs:
L’Institut de Philosophie de l’Université de Varsovie
L’Institut de Philosophie et de Sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences
La Société Polonaise de la Phénoménologie
De nombreux chercheurs ont annoncé leur participation au colloque, notamment :
Renaud Barbaras (Université Paris-Sorbonne)
Rudolf Bernet (KU Leuven)
Jagna Brudzińska (IFiS PAN)
Didier Franck (Université Paris-Nanterre)
Sara Heinämaa (Univ. of Helsinki)
Bonnie Mann (Univ. of Oregon)
Michael Alan Schwartz (Texas A&M Health Science Center, US)
Nicolas de Warren (Husserl Archives, KU Leuven)
Dan Zahavi (CFSR Univ. of Copenhagen)
Comité d’organisation:
Jacek Migasiński (President),
Marek Pokropski (Secretary)
Marzena Adamiak
Maja Chmura
Andrzej Leder
Monika Murawska
Wojciech Starzyński
Vos propositions d’intervention:
Veuillez nous faire parvenir vos propositions d’intervention, présentées sous forme d’un résumé
en anglais, français ou allemand
(500 mots maximum)
avant le 1er octobre 2016
à l’adresse suivante :
phenomenology2017@gmail.com.
Si vous voulez nous envoyer un résumé, veuillez s’il vous plait préciser parmi les thématiques qui vous sont proposées à laquelle votre travail corresponde. Les auteurs des propositions retenues seront notifiés de l’intégration de leur exposé au programme au plus tard le 1er décembre 2016.
La conférence est financée avec une subvention du Programme national pour le développement des sciences humaines. La participation est gratuite.